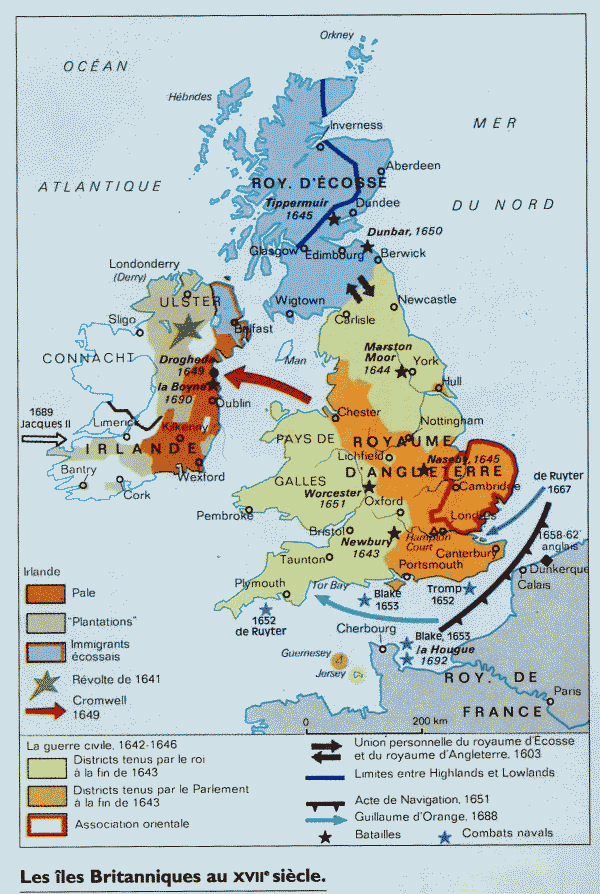c13artistique
Des récits britanniques
Pour une irlandaise d'aujourd'hui, l'appréciation de la Grande-Bretagne est fortement marquée par les tensions et plusieurs répressions de révoltes, dans lesquelles le britannique Cromwell fait figure de sinistre personnage, à l'occasion des heurts et malheurs qui ont parsemé la période de la dynastie des Stuart pour le compte de la couronne d'Angleterre. Chacun prendra le parti qu'il considérera comme juste pour décrire les liens entre l'Irlande et la couronne d'Angleterre entre le XVIIe siècle et aujourd'hui : le thème de Tristan et Ysolde, d'un lien idyllique, pur, et exempt de toute faute, vaudrait de ne rien connaître de toute réalité depuis la mort d'Elisabeth 1ère.
Tel ne peut pas être le cas d'un historien moderne.
Prenons des références admises par l'Education Nationale de notre République Française, et rapportons la teneur des articles produits dans "le Petit Mourre, Dictionnaire d'Histoire" aux éditions Larousse-Bordas 1998, carte inclue pour le XVIIe siècle.
Il se présente donc, à partir de la dynastie des Stuart, le fait avéré d’un contexte bien compliqué ; et cela conduit incontestablement à de véritables libertés d'opinion, en termes éventuellement poétiques, mais en essayant de présenter au titre du choix des mots des tournures un peu adaptées aux spécificités des Iles Britanniques.
du décès de la reine
Elisabeth Tudor en 1603

Il se présente donc, à la page Grande-Bretagne dans "le Petit Mourre, Dictionnaire d'Histoire", l’introduction suivante : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande fut constitué officiellement par l’Acte d’Union de 1707, suite à l’avènement de la dynastie écossaise des Stuart sur le trône d’Angleterre à partir de 1603.
Le propos n’est sans doute pas de promouvoir ici des questions de chevalerie celte du Moyen-Âge, ni de décrire par quels besoins il fut décidé de la décapitation du roi Charles 1er en janvier 1649 au bénéfice de la république de Cromwell. L’idée serait déjà presque ambitieuse de s’en tenir à préciser comment les choses se sont configurées sous la dynastie de la famille Tudor.
Cette dynastie a régné sur le trône d’Angleterre de 1485 à 1603 : à une époque où il était un peu compliqué d’unifier les intérêts des partisans de la famille Lancastre et ceux de la famille York alors régnante, un dénommé Henri Tudor, héritier des Lancastre de par sa mère, mit un terme à quelques querelles par son mariage avec une fille de la famille York, moyennant quelques faits d’armes probants ; ce fut le règne d’Henri VII, de 1485 à 1509. Mais c’est surtout son fils Henri VIII qui se fit largement remarquer, lui-même père d’Elisabeth 1ère
L’idée serait donc ambitieuse de présenter le règne de la fille dans les justes droits d’inventaires qui conviennent, le caractère original de la rencontre de François 1er en juin 1520 au Camp du Drap d’Or en Flandre s’inscrivant comme un fait du père, tandis que l’incitation aux prouesses artistiques de Shakespeare est un fait de la fille. La fille, tout autant que le père, a maintes fois défié les puissances espagnoles : globalement, la dynastie des Tudor s’est montrée soucieuse des intérêts de la couronne d’Angleterre.
En ce temps-là, les écossais s’exprimaient en langue écossaise, les gallois en langue galloise, les anglais en langue anglaise, et certains espagnols ne parlaient qu’en castillan. A l’avènement d’Henri VIII en 1509, il n’y avait, dans toute la chrétienneté occidentale, que le latin pour pouvoir prier Dieu. A la mort d’Elisabeth 1ère, il y avait, en Angleterre, une relative liberté du choix de la langue pour dire les prières : cette liberté de choix était aussi une façon de s’opposer à l’empire de Charles Quint, à travers des dispositions très anglicanes.
Des libertés d’opinion peuvent conduire à des appréciations très diverses quant à l’émergence de l’anglicanisme, dans un contexte où Henri VIII s’est aussi remarié un nombre de fois remarquable, et où certaines de ses épouses ne sont pas mortes qu’accidentellement. Une mention peut néanmoins se faire sur le nom de sa première épouse : l’espagnole Catherine d’Aragon.
Du mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn, Elisabeth Tudor est née en 1533, et elle a régné de 1558 à 1603. D’un royaume un peu excentré et un peu en retrait de toutes choses, l’Angleterre Elisabéthaine s’est aussi transformée en une puissance navale disposée à ne pas se faire impressionner par l’Invincible Armada espagnole.
Une mention pourra se faire d’un marin anglais nommé Francis Drake ; il lui fut accordé quelques moyens pour établir des perspectives d’une économie prospère, en dépit des utopies d’un Karl Marx dont nul ne pouvait alors soupçonner le moindre fondement ; en définitive, les faits et gestes d’un certain Cromwell feront simplement fonction d’amère réalité entre 1649 et 1660, pour ce qui ne mérite pas d’être lourdement répété.
On peut imaginer que Henri VIII et Elisabeth 1ère se sont prioritairement souciés de doter le royaume d’Angleterre de moyens appropriés pour se protéger d’un empire espagnol menaçant : l’observation de cette menace serait probablement une chose un peu caractéristique d’un récit britannique.
Des affaires londoniennes
au cours du Moyen-Âge

Carte in Encyclopédie Larousse Ed.2000
Sur des questions de têtes couronnées à l’époque du Moyen-Âge, il est admis que d’âpres batailles ont maintes fois stoppé net les ambitions de plusieurs lignées familiales. Même si, en définitive, on devra la formulation de Grande-Bretagne au roi écossais successeur d’Elisabeth 1ère, l’idée de restituer des lignées celtes sur le trône d’Angleterre n’est pas spécialement connue comme une chose bien couronnée de succès.
Prenons des références admises par l'Education Nationale de notre République Française, et rapportons la teneur des articles produits dans "le Petit Mourre, Dictionnaire d'Histoire" aux éditions Larousse, carte inclue pour le XVe siècle.
Naturellement, des personnages emblématiques des contextes compliqués entre les deux côtés de la Manche ne sont pas que des légendes, comme Richard Cœur de Lion raidement occis en 1199, ou Jeanne d’Arc réduite en cendres en 1431. Et un récit britannique pourrait présenter quelques sonorités disgracieuses, pour des oreilles françaises, sur des chapitres incluant en particulier la Guerre de Cent Ans, laquelle est officiellement datée de 1337 à 1453 avec quelques périodes de trêves.
Dans les faits, on se plairait à imaginer certaines formes jubilatoires d’un récit purement britannique dans la description de la Grande Charte, rédigée en 1215, et fondement du Parlement de Londres, régime représentatif qui est formellement institué depuis 1265. On y trouve en réalité les germes des âpres batailles entre la famille des York (rose blanche) et celle des Lancastre (rose rouge).
L’esprit de la Grande Charte sera diversement apprécié.
Pour les uns, il correspondrait essentiellement aux véritables déficiences du sinistre Jean sans Terre qui a régné sur l’Angleterre entre 1199 et 1216 ; et il ne sera que de reprendre l’origine du thème de Robin des Bois, lequel tourne en dérision les gestes du shérif de Nottingham dans la forêt de Sherwood.
Pour les autres, il peut correspondre à une forme de décision collégiale des conditions de ralliement à la couronne d’Angleterre ; à partir de cela, il peut inspirer quelques dépassements des éternelles querelles de clochers, voire même suggérer l’intérêt de s’unir au-delà des besoins de quelques particularismes traditionnels.
En 1265, le Parlement de Londres privilégie, dans les faits, une aristocratie anglo-normande qui se revendique dépositaire des droits venus d’Edouard le Confesseur. Celui-ci fut roi d’Angleterre entre 1042 et 1066, d’une lignée un peu saxonne et un peu normande. Sa succession fut l’objet de la bataille de Hasting, en octobre 1066, signant la défaite de Harold le saxon contre Guillaume le Conquérant venu de Normandie.
Certes, Edouard le Confesseur est devenu roi à la mort de son demi-frère Hardeknud, à une époque où la noblesse d’Angleterre était essentiellement saxonne. Mais, étant petit-fils du duc Richard 1er de Normandie de par sa mère, Edouard le Confesseur fournit la légitimité d’une nouvelle configuration anglo-normande.
Puis sur l’entrefait du mariage entre, d’une part le comte d’Anjou Geoffroi V surnommé Plantagenêt, et d’autre part Mathilde d’Angleterre, petite-fille de Guillaume le Conquérant, il apparaît, en 1133, la naissance de Henri, futur duc de Normandie, qui obtiendra de devenir Henri II roi d’Angleterre à partir de 1154 jusqu’à sa mort en 1189 : c’est le commencement de la dynastie des Plantagenêt dans cette configuration anglo-normande.
Et pour un ensemble de raisons, on ne peut passer sous silence le mariage en 1152 entre Henri Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine.
D’une part, le nouveau roi Henri II, en 1154, règne en définitive sur l’Angleterre, la Normandie, l’Anjou, le Poitou, le Maine, la Touraine et l’Aquitaine : on trouvera plus tard sur ce décompte les bons comptes d’une Guerre de Cent ans !
D’autre part, Aliénor d’Aquitaine est aussi une figure marquante parmi les têtes couronnées, un peu entre imaginations et vraies observations : on la sait comme épouse divorcée de Louis VII au moment de son mariage avec Henri II en 1152 ; on croit la savoir plus tard comme alliée de son fils Richard Cœur de Lion en conflit contre Henri II etc…
Pour s’en tenir strictement aux articles produits dans "le Petit Mourre, Dictionnaire d'Histoire", la vie d’Aliénor est essentiellement consacrée à l’Aquitaine. Née en 1122, fille et héritière du duc Guillaume d’Aquitaine et du Poitou, elle est donc successivement reine de France, puis reine d’Angleterre. Elle est mariée à l’âge de quinze ans à Louis VII. Doutant de la vertu de son épouse, celui-ci fait casser son mariage en 1152. Six semaines après, elle se remarie avec Henri Plantagenêt. A la fin de sa vie, elle se retire dans l’abbaye de Fontevrault : elle y meurt en 1204 et y est enterrée.
En définitive, l’esprit d’un récit britannique serait certainement de présenter le Parlement de Londres, tel qu’il a été instauré en 1265, comme défenseur des larges visées d’une aristocratie, dont les connaissances, les intérêts et les échanges divers ne se limitaient surtout pas aux seules frontières de l’Angleterre.
S’il est admis d’associer Jeanne d’Arc à la formule consacrée « boutons les Anglais hors de France ! », il n’en reste pas moins que les liaisons commerciales à partir du port de Bordeaux relevaient d’une importance claire et limpide, et même mieux que limpide : entre les préférences de la famille des Lancastre pour des registres plutôt rouges et celle des York pour des registres plutôt blancs, les fortes idées des anciens bretons de Jules César se sont trouvées diluées à travers d’occasions festives forcément bien arrosées…
Son enfance a été celle d’une fille d’un comte de la Cour d’Angleterre, remarié de bonne heure ; l’Histoire a retenue d’elle que son éducation dans les institutions aristocratiques avait fait d’elle une élève bien gentille, mais peu douée. Les faits ont voulu que la famille régnante était bien en peine pour trouver une future altesse chrétienne non catholique pour le très anglican Prince de Galles : ainsi fut faite notre jeune vicomtesse proprement Princesse de Galles à l'âge de vingt ans.
Certes, elle était peu douée au sens des critères aristocratiques de la famille régnante, ou sur l’art d’une Etiquette, dont le poids des traditions mettait une part trop belle à une manière très pincée de ne jamais extérioriser autre chose que les convenances bien connues : notre Princesse exprimait toute chose de façon très naturelle, et toute occasion d’exprimer un sourire pétillant lui valait de mettre en joie une large part de la population de Grande-Bretagne, tout autant que de courroucer une part de l’aristocratie, à commencer par la Reine, la propre mère de son époux.
Pour autant, rapidement, elle donna naissance à deux garçons, et ceci était bien l’essentiel pour la famille régnante : deux héritiers mâles ont donc été le cadeau qu’elle fit à son époux Prince de Galles ; lequel lui rendit comme une sorte d’indifférence sur bien des questions, autant sur les relations difficiles qu’elle avait avec la Reine, que sur le thème d’une vie conjugale qui se vida lentement de tout contenu concret.
Notre Princesse connut alors un temps où elle accepta de se montrer assez rarement, un temps où on lui a connu l’expression extériorisant du tourment, un temps qui fut celui de la maladie, des troubles du domaine du psychisme et tout particulièrement les affres d’un cycle fait de boulimies et d’anorexies : le conte de fée de son mariage se transformait en situation appelant une décision réfléchie de sa part.
Un moment vint, dix années environ après son mariage, où sa décision fut d’en appeler officiellement pour mettre un terme à son mariage, et qu’annonce soit faite de la séparation conjugale : sa décision était de pouvoir s’impliquer partout où elle trouverait utilité à offrir son regard si doux, son expression de gentillesse si spontanée, son petit sourire si affectueux, que chaque moment de joie partagée était un petit pas supplémentaire pour se rapprocher de la petite sorte de lumière qui éclaire le sens de la vie. Sa décision était de pouvoir s’impliquer librement dans les actions destinées à toutes sortes d’enfants sans perspectives : les petits incurables, les estropiés de toutes sortes de conflits de par le monde, etc…
Vinrent alors les cinq dernières années de son existence qui transformèrent, de l’aveu du Gouvernement britannique, le statut d’ex-Princesse de Galles, en statut de véritable Princesse du peuple. Elle n’était pas douée au sens des critères aristocratiques de la famille régnante, mais elle a réussi à titre posthume à faire admettre à la famille royale l’intérêt de s’impliquer un peu dans ce qui fait aussi le quotidien d’une population.
Elle s’appelait Lady Diana Spencer, son mariage fut célébré dans la cathédrale St Paul en 1981 et son enterrement dans la cathédrale de Westminster en 1997.