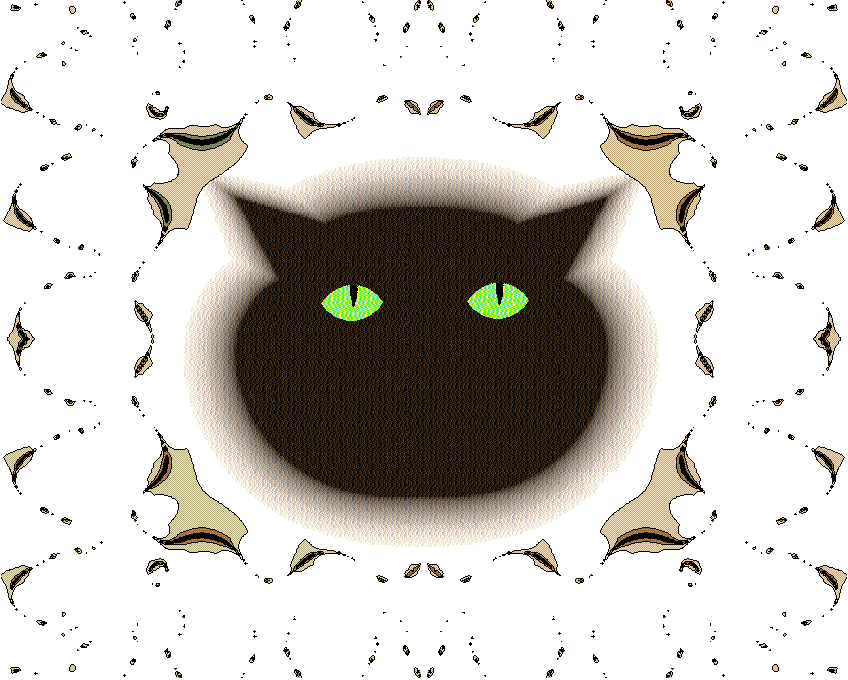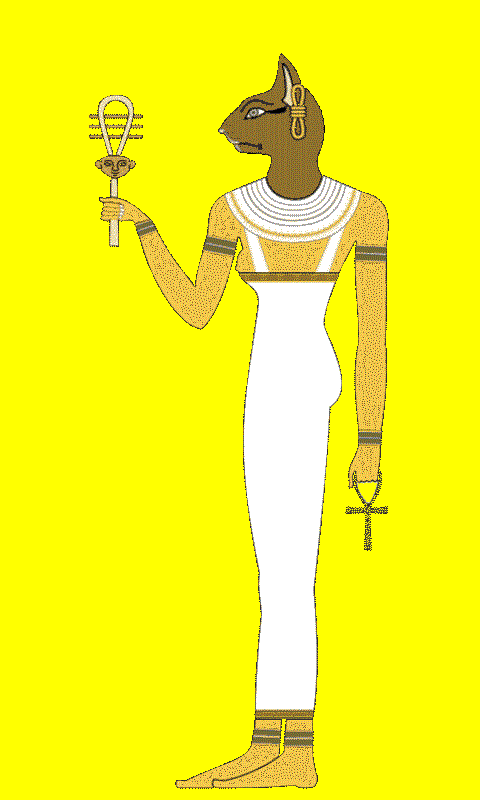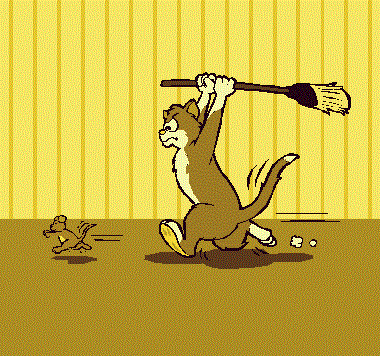c13artistique
des histoires de félins
des histoires au sens des biologistes

A partir des ouvrages encyclopédiques, il s’agit donc de s’accorder sur le sens qu’un mot peut porter, en reconnaissant des subtilités conformes à un bon usage de la langue française.
D’un premier exemple qui pourrait amener quelques disputes ni drôles ni amusantes, il se trouve que choisir le mot « fauve » pour caractériser certains grands félins s’observe effectivement dans le bon usage de la formule « du rugissement d’un fauve ».
Pour autant, le mot « fauve » peut aussi se présenter en tant qu’adjectif, pour caractériser une coloration qui s’approche simplement d’une teinte rousse : la distinction entre ce qui sera qualifié de fauve et ce qui ne le sera pas pourrait faire rugir de colère un apprenti coiffeur admirateur de Ionesco et de la Cantatrice Chauve !
Pour s’en tenir à des propos supposés raisonnables, le dictionnaire Larousse Ed.2000 suggère que les bêtes fauves seront les mammifères dont le pelage comporte des poils de teinte rousse, tels que le lion et le tigre, mais aussi très explicitement le daim et tous les cervidés.
Comme il se trouve que l’adorable félin qui me tenait compagnie dans ma prime jeunesse ne sera jamais reconnu se trouver dans le périmètre des bêtes fauves, en dépit de toutes les furies d’un apprenti coiffeur rugissant, il s’agit de s’accorder sur d’autres termes pour particulariser ce qui réunit le lion et le chat, le tigre et le guépard, le puma et le léopard, le jaguar et la panthère, etc…
Des observations un peu judicieuses conduisent à préciser que les félins sont tous des mammifères carnivores, dont l’extrémité des pattes est dotée, d’une part, de griffes, et d’autre part, d’éléments élastiques convexes, appelés coussinets.
A ce stade, le daim peut ravir à plaisir des admirateurs de la Cantatrice Chauve, les fortes disputes seront simplement admises entre les tenants du chat et les partisans du chien : et s’il s’agissait d’introduire une véritable difficulté, il se trouverait encore quelques balles perdues dans on ne sait quel mauvais terrain de chasse !
En effet, les canidés comme les félidés sont tous des mammifères carnivores dotés de griffes et de coussinets.
De plus, on ne saurait ignorer que la famille des canidés comporte des animaux qui, à défaut de tenir en respect une harde de lionnes affamées, n’en sont pas moins intéressants dans le bestiaire des fauves d’une manière bien générale : outre le loup européen, il s’agit de ne pas oublier le coyote américain et le chacal africain !
Parmi ce petit monde, une mention spéciale, ès qualité du pelage aux poils de teinte rousse, doit retenir toute l’attention des détenteurs d’un poulailler : la famille des renards, qui inclut aussi les petits fennecs africains. Et cette famille entre bien dans le périmètre des canidés.
Car la réalité du classement découle de la perspicacité des spécialistes en biologie, en observant précisément que les félins sont les mammifères carnivores dont l’extrémité des pattes est dotée de coussinets et de griffes rétractiles.
L’honnêteté intellectuelle inciterait à reconnaître que les félidés se singularisent en plus par une vision nocturne véritablement très performante, une dentition un peu spécifique, une aptitude aux sauts qui leur est un peu particulière, etc…
Mais le besoin des fortes disputes trouve un authentique avantage dans l’argument des coussinets et des griffes. Il ne sera que l’occasion d’étendre les discussions à quelques volatiles carnassiers, pour s’entendre comme suit concernant une certitude de première importance : l’usage veut que les pattes des aigles et faucons ne présentent surtout pas des griffes, mais des vraies serres, bien capables de faire taire tout excès d’honnêteté intellectuelle.
L’ultime réalité se résume par l’irrémédiable situation qui oppose des chasseurs et des félins : l’intérêt des griffes rétractiles n’est pas une chose secondaire, c’est même une source importante de véritables incompréhensions !
Le chapitre précédent a pris en considération quelques subtilités conformes à un bon usage de la langue française : il convient maintenant de préciser ce qui donne bonne convenance, de façon culturelle en France et en Navarre, aux fortes idées du respect du gibier parmi lequel les petits lapins, entre d’une part, les chasseurs sachant chasser, parmi lesquels les chats, et, d’autre part, les gardes-chasses, parmi lesquels les chiens.
D’un premier abord, les considérations des historiens et des historiennes sont culturellement présentées suivant un ordre chronologique, par lequel il convient de situer les origines des fortes idées, d’une époque où l’écriture était encore balbutiante, mais où la préhistoire n’avait déjà plus vraiment d’avenir.
Des premiers fondements
Il s’agit donc de présenter le contexte qui sied à l’ancienne divinité Bastêt, déesse à tête de chat, dans le panthéon primitif du temps de l’Egypte Antique. Les références restent celles du chapitre précédent, des ouvrages encyclopédiques reconnus par l’Education Nationale ; et le propos n’est que de retenir quelques mots, parmi les données culturellement pertinentes aux yeux des chasseurs sachant chasser.
D’une époque où l’agriculture prenait son essor sur les bords du Nil, on imagine que les petits rongeurs dévastateurs des magasins et des entrepôts pouvaient contribuer au prestige et à toute l’importance du culte de Bastêt.
On peut aussi se représenter la religion primitive de l’Egypte Antique comme vénérant, d’une part, des divinités cosmiques – Rê (le soleil), Nout (la voûte céleste), etc… – et, d’autre part, des divinités locales – Ptah à Memphis, Amon à Thèbes, etc…
Puis à partir de la XIIe dynastie, Amon obtient une prééminence aux côtés de Rê, constituant dès lors la divinité suprême Amon-Rê, et faisant apparaître les éléments prestigieux autour de Thèbes, le grand temple de Louqsor, le domaine de Karnak, la Vallée des Rois, etc…
Le culte de Bastêt se représente en toute vraisemblance dans la composante des anciennes divinités locales, en particulier sous l’appellation plus judicieuse de Bastis, dont l’endroit du culte, Boubastis, peut se situer à l’est du delta du Nil.
Parmi les données beaucoup moins claires aux yeux des chasseurs sachant chasser, il se trouve quelques histoires qui décrivent Anubis, une divinité à tête de chacal, qui prodiguait des interventions dans les rites funéraires égyptiens : des interventions dont on préfèrera ne pas trop commenter dans quelle mesure on s’en réjouissait…
De toute façon, les savoirs de l’Egypte Ancienne sont réputés être entourés de nombreux mystères, et ne devaient manifestement pas être divulgués sans précaution. Les différentes étapes d’une momification, qui seraient aussi l’occasion de présenter la divinité Anubis, ne permettront pas de démentir cette manière de développer des choses bien mystérieuses.
Mais on ne saurait passer sous silence une autre figure mythique importante dont le regard contemple l’humanité depuis un nombre significatif de milliers d’années : le sphinx, à tête humaine sur un corps de lion, à Gizeh, au pied de la pyramide de Khephren.
Le sphinx a incontestablement la fonction d’évoquer quelque chose d’aussi imposant qu’un grand félin devant les frêles créatures humaines que nous sommes : c’est, à Thèbes, la fonction de l’allée bordée d’une suite de sphinx pour rejoindre le grand temple d’Amon à partir du domaine de Karnak.
Toutes choses ramenées à leur dimension, il se trouve que les petits rongeurs dévastateurs s’abstiennent aussi de parader fièrement devant un adorable petit félin capable d’être un peu joueur, sans présumer pour autant des aspects dévastateurs d’une quelconque comparaison !
Du renouvellement des fondements
Le sphinx occupe aussi une place mythique dans la Grèce Antique, et dans un contexte chronologique beaucoup plus proche de nous que celui de Gizeh.
Les représentations d’un bestiaire imaginaire se sont largement développées dans toutes sortes de travaux artistiques de l’Antiquité Gréco-Romaine, incluant des graphismes de monstres fabuleux, qui font référence à des mythes grecs très précis, comme ceux de la Chimère, ou ceux du Centaure, etc…
Sur le principe d’une tête humaine qui apparaît sur le corps d’un animal, des travaux artistiques ont aussi associé, aux divers effets d’animalité, des orientations sexuelles souvent prépondérantes : et ceci n’est finalement même pas démenti dans le mythe d’Œdipe, dont le récit comporte l’épreuve du sphinx, dans le Golfe de Corinthe.
On peut aussi considérer le fait d’une intense circulation des idées dans le monde méditerranéen : on ne peut parler de Thèbes, sans préciser s’il s’agit de la cité de Moyenne Egypte consacrée à Amon-Rê, ou s’il s’agit de la cité grecque, en Béotie dans le Golfe de Corinthe, là où se situe l’épreuve du sphinx dans le mythe d’Œdipe.
De plus, on peut remarquer que le principe des animaux fantastiques correspondrait aussi à une sorte de pictogramme « international », pour avertir les voyageurs de passage qu’il serait préférable de s’éloigner, pictogramme telle l’effigie du griffon, à moitié lion à moitié oiseau rapace, à l’entrée de divers tombeaux dans le monde méditerranéen.
Plus spécifiquement grecque, le culte d’Artémis se rapportait à une large variété d’aspects, dont les éphésies ne seraient qu’une sorte de résumé trop court.
Rappelons que le récit de l’Iliade et de la Guerre de Troie attribue au Roi Agamemnon, et de ses prérogatives à partir d’Argos près de Corinthe, toutes sortes de causes funestes, dont celle d’avoir souhaité le sacrifice de sa fille Iphigénie « pour apaiser l’hostilité d’Artémis » : il s’y trouve des éléments de tragédie, certes spécifiquement grecques, mais très largement incompréhensibles aujourd’hui !
Le propos n’étant pas de décrire des pratiques antérieures à Abraham, mais de décrire des aspects du culte rendu à Artémis, l’épaisseur de certains ouvrages peut en suggérer toute la richesse, voire même les différentes évolutions entre une époque du Roi Agamemnon et une époque devenue chrétienne byzantine.
Du culte rendu à la déesse Artémis, il se fait donc d’en mentionner en particulier l’aspect d’un lien sacré qui était le sien avec la faune en général, et avec les bêtes fauves au sens très précis des mammifères dont le pelage comporte des poils de teinte rousse : une référence typique de la divine chasseresse et de ce bestiaire très précis du lion, du renard, du daim, du chevreuil, etc…
Le thème des félins est, par lui-même, indissociable de tout ce que l’humanité peut attribuer aux caractères des lions, parfois de ce qui suscite l’admiration, parfois de ce qui suscite la crainte, et beaucoup plus rarement de ce qui amènerait une totale indifférence !
Le thème de la fosse aux lions, et les détails des jeux du cirque de l’Antiquité Romaine, s’inscrivaient effectivement dans ce principe des grands félins qui suscitent beaucoup d’émotions ; puis l’antique effigie du griffon à tête de lion a même connu des utilisations qui ont perdurées ici ou là, au titre d’insignes royales, dans le monde du Moyen-Age européen, suscitant quelques hippogriffes d’anciens savoirs héraldiques.
Dans la même logique, la représentation de la Chimère, savante combinaison du buste d’un lion, du ventre d’une chèvre et de la queue d’un serpent, a abondamment servi à des buts pédagogiques, pour l’ensemble de la chrétienté du Moyen-Age, dont il faut supposer qu’elle s’exprimait avide des détails les plus délicieux, sur fond des anciennes tragédies grecques.
Dans un tout autre style, la langue française s’honore d’une vieille dénomination pour le renard, qu’on appelait le goupil, ainsi qu’une ancienne tradition sous l’appellation « du Roman de Renart » : l’orthographe du Roman présente très explicitement un « t » qui fera enrager tous les correcteurs d’orthographe modernes !
Ce Roman fait intervenir différents personnages, dont les principaux sont le goupil (Mr Renart), le loup (Mr Ysengrin), le lion (Mr Noble), le chat (Mr Tibert), etc…
Une version latine de ce Roman, qui précise toute la rivalité entre le loup et le goupil, semblerait être l’ouvrage « Ysengrimus » de Nivard de Gand en 1148, par la sorte de mot-valise germanique isan-grim (traduire fer-masque).
Dans ce Roman, le principe est celui d’une communauté de personnages où n’intervient aucune représentation humaine, étant évident que le lion Mr Noble occupe la fonction du grand seigneur, qui peine parfois à se faire comprendre de ses bons sujets : dans l’ensemble, la tonalité se rapproche des principes de la satire sociale.
Au sens d’une chronologie stricte, ce Roman se situe plusieurs siècles après les œuvres du grec Esope, et plusieurs siècles avant celles de Jean de la Fontaine.
Mais au sens d’une étude des mœurs, ce Roman est totalement particulier à l’organisation des communautés rurales du Moyen-Age européen. Et ce contexte très précis réussit à attribuer aux apparitions du lion, parfois ce qui suscite de l’admiration, parfois ce qui suscite de la crainte, et parfois aussi ce qui suggère toute l’impertinence d’une vraie indifférence !
La véritable spécificité de ce Roman est de décrire, à travers les comportements du goupil, toutes les sophistications d’une intelligence aux dépens d’une brutalité ordinaire : en d’autres termes, il s’agit de toutes sortes de ruses, aux dépens d’un loup supposé très fort musculairement.
L’inimitié profonde de l’humanité par rapport au loup conduit à apprécier les ruses du goupil, et donc à savourer chacun des détails produits dans « le Roman de Renart ». Inversement, on imagine que d’hypothétiques défenseurs du loup peuvent qualifier les savoureuses descriptions de toutes ces ruses comme une détestable promotion des traîtrises du goupil. De toute façon, l’entente correcte n’est surtout pas le propos.
D’une manière générale, les valeurs courtoises de la chrétienté du Moyen-Age pouvant transparaître dans des représentations animalières ne semblent pas atteindre le domaine des canidés ; si ces valeurs trouvent mieux leur place dans un monde équestre avec ou sans licorne, ou l’univers des grands volatiles dans lequel des cygnes pourraient probablement figurer, on ne pourra finalement pas sous-estimer l’importance du lion.
Mentionnons que les données du roman « Yvain ou le chevalier au lion » portent sur des idées de chevalerie de la cour du Roi Arthur, en incluant les interventions d’un lion mystique : celui-ci apporte son aide dans les effroyables épreuves imposées au valeureux chevalier Yvain.
Il se trouve que ce roman s’inscrit dans un cycle arthurien attribué à Chrétien de Troyes vers 1170. Et il se trouve que le fils aîné Richard, né en 1157, du mariage entre Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine, sera finalement connu sous l’appellation de Richard Cœur de Lion : le thème du lion prend ici une résonance bien précise.
Par conséquent, il ne sera acceptable en aucun cas de vilipender outrancièrement la réputation des félins en général, sauf à chercher à se fâcher avec l’Aquitaine toute entière !

L’artifice des représentations animalières, pour décrire les complications de certaines intentions particulièrement humaines, se présente aussi à la manière d’un procédé commode et fort bien connu depuis longtemps : le thème du chat y trouve sa place, à qui l’on prête facilement des préoccupations qui échapperaient à toute raison.
La complexité du chat pourrait particulièrement contrarier cette formule « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément » : il pourrait se faire, à toute occasion, de mettre une patience judicieuse pour obtenir la démonstration d’une situation nouvelle, aussi probante qu’inattendue, par laquelle les mots qui conviennent le mieux s’avèrent être en fait difficilement ceux du langage ordinaire !
On peut même croire que, jadis, le thème du chat dans des travaux d’écriture n’était pas très éloigné du thème des sorcières et autres hérétiques condamnés au bûcher. Les faits littéraires dont on cherche ici quelques avantages sont, tout au contraire, ceux des représentations du chat sous les véritables qualités des êtres sensibles.
Le cas du Chat Botté de Charles Perrault
En référence à l’édition des Contes, Ed. J-C Lattes 1987, qui reproduit celle de 1695, les premières phrases du Chat Botté de Charles Perrault peuvent faire état des tournures suivantes : « Un Meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son Moulin, son Âne, et son Chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le Notaire, ni le Procureur, n’y furent appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L’aîné eut le Moulin, le second eut l’Âne, et le plus jeune n’eut que le Chat. »
L’habileté de cette introduction assez peu réjouissante consiste à se représenter, d’une part, les facilités du fils le plus jeune à exprimer quelques ressentiments sur les faiblesses de sa fortune, et d’autre part, la détermination de notre Chat Botté à bien démontrer le contraire, par quelques manières aussi probantes qu’inattendues. Il est évident que, sous la plume de Charles Perrault, les aspects valeureux du petit félin conduisent à la conclusion qui s’impose, du jeune fils qui obtient en définitive d’être marié à la fille du Roi par l’ensemble des mérites du Chat, et permettant donc d’envisager une tournure finale comme il se doit « des jeunes gens qui vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants. »
Parmi les éléments judicieux qui figurent dans l’édition des Contes, Ed. J-C Lattes 1987, on trouvera l’article que Mr Sainte-Beuve a consacré à Charles Perrault, sa vie et son œuvre, dans le journal Le Constitutionnel, en date du 23 décembre 1861 : l’article présente quelques détails sur l’art et la manière des faits littéraires de la fin du XVIIe siècle, et comment Charles Perrault avait ses entrées à la toute récente Académie Française. On peut encore convenir que tout ceci se rapporte finalement à des éléments qui trouvent place dans des ouvrages encyclopédiques reconnus par l’Education Nationale, sauf à préciser clairement des arguments de vraies disputes entre Boileau et Perrault, dans cette toute récente Académie Française.
On se doute que, au-delà de leurs disputes, Boileau et Perrault se reconnaissent, l’un comme l’autre, à la fois dans la démarche d’esprit intitulée Défense et Illustration de la Langue Française, et tout autant dans le même souci concernant les véritables qualités des êtres sensibles. Mais Boileau se situe dans le goût littéraire des thèmes devenus classiques d’une Antiquité Gréco-Romaine, tandis que le travail d’écriture de Perrault fait une promotion des formes de narration naïves et populaires.
Alors que l’un et l’autre font apparaître un même sens du merveilleux dans leurs travaux, un fait de modernisme est reproché à Charles Perrault, au motif d’une impertinence supposée à l’encontre des Anciens ! En réalité, peu nombreux sont les chats qui comprendraient cette dispute entre Boileau et Perrault.
Et en toute bonne mesure, on ne retiendra que la force de cette narration par laquelle un seigneur ogre, qui terrorisait de ses abominations toutes les populations avoisinantes, et qui aurait volontiers fait l’éloge des Anciens, se changeait à l’occasion tantôt en éléphant taciturne, tantôt en lion affamé : en définitive, il fallut toute l’habileté du Chat Botté, pour que le seigneur ogre admette de se changer aussi en souris, permettant aussitôt à notre valeureux petit félin de n’en faire qu’une bouchée, d’une manière aussi probante qu’inespérée, et de débarrasser ainsi la région de cette rare abomination sans nom.
L’occasion d’un regard plus large sur le thème du Chat Botté
A l’origine, il fut donc reproché à Charles Perrault d’avoir puisé son eau à la source des narrations orales des contes populaires, plutôt qu’aux sources des anciens grimoires des meilleures bibliothèques. D’un côté, cela ne présente aucun préjudice à la Défense de la Langue Française, qui se trouvait être l’objet principal et commun à tous. D’un autre côté, cela conduit aussi à élargir le regard sur ce qui pouvait constituer des traditions populaires au XVIIe siècle.
Vouloir élargir le regard serait aussi renoncer à préciser des données dans leurs détails, pour admettre des points de vue sur un ensemble de données éparpillées : s’agissant des contes populaires dont des récits étaient connus au XVIIe siècle, la tentation est forte de résumer nos connaissances aux seules données des Contes de Perrault. Pour autant, d’autres données existent, certes sous forme de résultats qui ne sont en rien comparables à ce qu’on obtient du remarquable travail de Charles Perrault ; mais le souci d’un autre regard conduit à des observations parfois bien intéressantes.
Par simple jeu, tout un chacun peut effectivement s’aventurer à cette expérience d’un autre regard, moyennant le renoncement aux références classiques connues de l’Education Nationale : par exemple, on peut présenter, à un moteur de recherche anglophone sur internet, la question « fairy tale about a cat » pour un avis sur les fables concernant un chat, ou même une question « about Puss in Boots » pour ce qui concerne précisément le Chat Botté ; on peut aussi orienter le regard sur bien autre chose que des faits strictement littéraires.
En principe, il apparait normalement des mentions d’un italien, Giovanni Francesco Straparola, qui avait précédé Charles Perrault d’un large siècle, concernant un travail d’écriture intitulé « Il gatto con gli stivali », qu’il faut traduire par « Le Maitre Chat ou le Chat Botté » : cela peut conforter, dans une bonne mesure, cette idée qui fut reprochée à Charles Perrault, d’avoir puisé son eau à la source des narrations orales des contes populaires.
Dans un style italien consacré à des pièces de théâtre, pour ne pas dire tout simplement dans un style commedia dell'arte, on se représentera volontiers un personnage de Chat Botté superbement joueur et étonnamment farceur. D’un côté, ce caractère intentionnellement amusant n’est pas parmi les aspects dominants qui sont attribués au travail formalisé par Charles Perrault. D’un autre côté, le thème du chat est effectivement porteur des meilleures occasions de se montrer un peu joueur quand même.
Pour peu d’accepter, ne serait-ce qu’un instant, de jouer aussi à se faire peur, par exemple lors d’une confrontation avec un terrible seigneur ogre, le personnage du Chat Botté peut certainement servir la cause des beaux parleurs, que des personnes bien acrimonieuses qualifieraient injustement de simples baratineurs : cela trouve naturellement toute sa place dans une promotion des contes populaires.
Le travail des créations cinématographiques a singulièrement bien évolué depuis les premiers films muets en noir et blanc des origines, et le propos ne sera surtout pas de s’aventurer ici à imaginer les développements qui feront les succès de demain. D’ailleurs, personne ne devrait valablement tenir pour certain un fait d’obsolescence dans certains traits d’humour du personnage représenté par Charlie Chaplin à l’époque des premiers films muets.
On se représente plutôt que le fait d’obsolescence s’applique aux difficultés et aux solutions qui apparaissaient incontournables, dans les conditions de tournage de cette époque : l’apparition d’un véritable félin à l’écran ne pouvait être que particulièrement furtive, avec tout ce que cela comportait en aspects contraignants sur la réalité du scénario par rapport à un véritable animal. Dès lors, on se représente tout l’intérêt du dessin animé, dans le contexte, certes obsolète, des créations cinématographiques au moment des riches heures du XXe siècle.
Le thème des riches heures serait celui d’une démarche d’esprit dans le domaine des créations artistiques : celui du mécène qui appréciera l’ouvrage, à la manière du Duc de Berry. Les faits cinématographiques les mieux répertoriés pour le XXe siècle s’inscrivent largement dans le bon respect des valeurs admises à Hollywood : en cela, un dessin animé n’était même pas une occasion de déroger inconsidérément à ces bonnes manières.
La question du modernisme, à laquelle Charles Perrault s’est trouvé confronté à l’époque de la toute récente Académie Française, se présente d’une façon un peu comparable à l’artiste Walt Disney dans un univers hollywoodien tout récent : des prises de liberté sur des procédés de mises en scène ne sont une occasion, ni de déroger inconsidérément quant au contenu mis en scène, ni de ridiculiser des valeurs prônées dans les meilleures mondanités du moment.
Pour autant, il ne devrait nuire à la réputation de personne de faire savoir qu’un univers hollywoodien, adepte de la technologie des films en couleurs, était bien évidemment en capacité de se moquer un peu de certaines valeurs aristocratiques prônées en Europe avant 1914.
Des aristos et les Aristochats de la Belle Epoque
Le propos est donc de mettre à l’écran un film complet dont les personnages principaux ne sont effectivement que des chats, mais des chats représentatifs tout de même de l’écart qui sépare les individus, entre ceux qui témoignent avoir reçu une bonne éducation, et ceux dont l’éducation est manifestement à refaire : l’affaire des Aristochats se situe à Paris en 1910, à partir de l’excellente maison d’une ancienne diva de l’opéra, Madame Adelaïde Bonfamille.
Au sens des projets imaginés par les Studios Walt Disney, on se situe dans le registre des comédies musicales, des dessins animés dont la réalisation fut confiée à Wolfgang Reitherman : la Belle au Bois Dormant (1959), Merlin l’Enchanteur (1963), le Livre de la Jungle (1968), puis les Aristochats (1970). Au-delà des incertitudes qui peuvent se manifester d’une manière inéluctable, on trouvera néanmoins des aspects intéressants à travers des questions de chronologie…
Pour qui se contentera d’un petit résumé très succinct, les Aristochats pourront tenir dans la formule « d’un chat de gouttière au secours d'une chatte de race, entre salons mondains et sombres machinations » : cette formule existe en tant que telle dans le dictionnaire Larousse Ed.2000, et elle pourrait donner envie d’imaginer des réalités relativement peu dépendantes d’une époque plus que d’une autre. Les détails du scénario et la mise en scène des sombres machinations ne laissent pourtant aucun doute sur l’ineffable saveur de la Belle Epoque qui a inspiré Emile Zola, Toulouse-Lautrec et quelques autres.
De plus, le propos ne sera pas de proposer une formule un peu abrupte comme celle du chat de gouttière se proposant de dégourdir qui de droit etc… Sur le thème des riches heures qui caractérise une démarche d’esprit dans le domaine des créations artistiques, les productions des Studios Walt Disney s’inscrivent dans le respect des bonnes mœurs d’un public, lequel appréciera par ailleurs le passage au tiroir-caisse comme il se doit.
Il s’agit donc d’un regard sur les difficultés à harmoniser la vie quotidienne des différentes classes sociales à Paris en 1910 : Duchesse, la chatte de race, et sa progéniture Berlioz, Marie et Toulouse, se trouvent effectivement en constantes difficultés ; mais l’espèce de révolution russe, qui les guette en permanence, provient des humains, et spécialement du majordome Edgar qui souhaite s’opposer aux volontés de la maîtresse de maison Madame Adelaïde Bonfamille.
Il se fait donc un contexte regrettablement compliqué, par lequel un chat de gouttière, nommé O’Malley, se démène au secours de Duchesse, une chatte de race, entre salons mondains et effroyables machinations du majordome Edgar. Et on convient, pour s’inscrire un peu dans le sens de l’Histoire qui n’épargne pas les aristos de certaines manières, que Duchesse et O’Malley réussiront finalement à partager autant leur destin que leur quotidien !
L’occasion d’un regard plus large
Différentes anecdotes portent à croire que l’élaboration d’un script, concernant les Aristochats, a été relativement laborieuse, voire même un peu tributaire de certaines réalités qui ont affecté la Walt Disney Company durant la décennie des années 1960 : il y a en cela une véritable matière qui incite à s’écarter des strictes données des ouvrages encyclopédiques reconnus par l’Education Nationale.
Dans le cadre de ces strictes données, on obtient néanmoins de savoir que la réalisation de dessins animés comme Cendrillon (1950), ou encore la Belle et le Clochard (1955), avait été confiée à Clyde Geronimi : les affaires des Studios Walt Disney ne se présentaient pas comme l’exclusivité d’une personne précise. On convient que le succès du premier long métrage, Blanche-Neige (1937), servait de référence comme de caution morale quant à l’autorité du patron Walt Disney : on se doute que son décès en 1966 a forcément affecté les travaux en cours.
Concernant la production de la Belle au Bois Dormant (1959), il serait probablement pertinent de retenir, dans les faits, le nom de Clyde Geronimi pour la conduite des travaux, plutôt que celui de Wolfgang Reitherman alors un peu novice ; mais des questions d’attribution se posent vraiment sur toute la période entre 1960 et 1966, et de toute évidence pour la réalisation des 101 Dalmatiens (1961). C’est dans ce contexte que le script concernant les Aristochats a été soumis au patron Walt Disney, et retouché par lui-même : une attention toute particulière s’est même fixée sur le personnage du chat certifié 100% de gouttière (full name: Abraham de Lacy Giuseppe Casey Thomas O'Malley).
Le caractère de comédie musicale qui prévaut pour la réalisation des Aristochats, et qui sied tant à l’univers de la maîtresse ancienne diva de l’opéra, concerne aussi la bande de copains du chat O'Malley, qui savent entonner la plus belle des chansons « Ev'rybody Wants to Be a Cat ». Walt Disney lui-même a choisi l’acteur qui fera la voix du chat O'Malley dans son succès anglophone : ce sera Phil Harris (cf "An encore purr-formance for 'The Aristocats'" de Howard Pearson, in Deseret News, 8 dec 1980). En aucun cas il ne s’agit d’une reconstitution des possibilités musicales connues à Paris du temps des premiers films muets en noir et blanc : il s’agit bien au contraire de promouvoir des talents d’Amérique de la décennie des années 1960.
Dans l’ensemble, un thème central dans le film des Aristochats est le besoin d’une figure paternelle bienveillante faisant face aux risques encourus par la petite progéniture, entre les petites bêtises du jeune Berlioz, les imprudences innocentes de la jeune Marie, et des égarements totalement inconséquents du jeune Toulouse : la mise en scène du personnage O'Malley a fait l’objet d’un certain nombre d’ajustements entre le script initial et la version définitive.
Finalement, la solution qui paraît convenable à Wolfgang Reitherman pourrait se formuler simplement comme suit : de même que l’acteur chargé de prêter sa voix au personnage de Baloo, dans la version anglophone du Livre de la Jungle, a un peu orienté les attitudes du personnage dans un style typique de Wallace Beery, de même Phil Harris, chargé de prêter sa voix au personnage de O'Malley, a forcément orienté les attitudes du personnage dans un style un peu typique de Clark Gable (cf "The Aristocats for Christmas" in Ottawa Citizen, 18 Dec 1970).
Une fois que les explications correctes sont formulées de la manière la plus sincère, il reste néanmoins une difficulté, qui est celle d’accepter un père adoptif, et dans un contexte où le thème d’une paternité pourrait soulever un nombre de questions ni convenables ni convenues : s’agissant concrètement des espèces félines, chacun sait par avance qu’il est totalement inenvisageable d’adopter un petit chat ; il est tout au plus concevable d’essayer de se faire adopter par un petit chat !
L’effet de quelques illustrations
Dans cette affaire, tout commence par un chat de mauvais poil comme cela arrive de temps en temps. Il convient de le laisser un peu en paix. Retrouvant le sommeil qui peut lui être léger mais bénéfique, il s’épanouit finalement dans des rêves secrets, qui refont de lui un chat de bonne humeur



Du montage d’une histoire


Dans cette affaire, tout commence par un chat sérieusement dubitatif quand même, les perspectives d’une histoire pouvant contrarier juqu’au respect qui convient pour l’heure du repas qui n’a que trop tardé !
Le principe qui se présente ici est de laisser à l’internaute le soin de préciser tous les détails de l’histoire, dont on sait qu’elle se conclut forcément bien, au bon motif qu’il s’agit, sans aucune contestation possible, d’un chat fort sympathique.
Le principe qui se présente ici est donc de laisser toute liberté à l’internaute dans l’utilisation des divers éléments graphiques, pour préciser de véritables histoires en fonction des situations : il y a d’une part les éléments graphiques du chat fort sympathique, et d’autre part cette première proposition de décor champêtre dans les herbes folles.
Ce décor champêtre se décompose comme suit :


Il y a donc d’une part le décor champêtre dans sa globalité, et d’autre part le décor réduit aux herbes folles du premier plan : un élément graphique du chat sympathique pourra être superposé dans un premier temps au décor champêtre dans sa globalité, puis le décor réduit aux herbes folles pourra être superposé ensuite sur l’image qui prend forme.
La superposition concernant l’élément graphique du chat sympathique pourra se faire simplement, considérant la teinte de fond transparent comme la couleur blanche par défaut. La superposition des herbes folles se ferait en précisant pour teinte de fond transparent la couleur noire, du fait des teintes blanchâtres dans le premier plan.
On pourra aussi procéder, une fois le chat sympathique superposé au décor champêtre global, à l’astuce dite inversion des couleurs appliquée à la fois à l’image en cours et au décor réduit des herbes folles, permettant en fait la superposition des herbes par la teinte de fond transparent blanche par défaut : le résultat final sera alors rétabli par une ultime inversion des couleurs.
Il sera surtout espéré toutes sortes d’initiatives, et toutes sortes de petits rajouts d’éléments graphiques supplémentaires, qui seront laissés à la discrétion de l’internaute, pour préciser les meilleures histoires en fonction des situations.
Affaire à suivre…